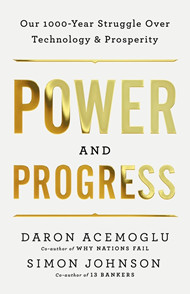
Our 1000-Year
Struggle Over
Technology and
Prosperity
Daron Acemoglu et Simon
Johnson, PublicAffairs
New York, NY, 560 pages, 32 dollars
Imaginez qu’un travailleur sur le point d’être remplacé par un robot s’entende dire : « Réjouis-toi, ton arrière-arrière-arrière-petit-fils bénéficiera de ces progrès technologiques. Malheureusement, toi, tes enfants et leurs enfants vivrez des moments difficiles, mais ne te comporte pas comme un égoïste réfractaire au progrès et n’entrave pas la prospérité future ». C’est en substance ce qui est arrivé aux ouvriers du textile durant les premières décennies de la Révolution industrielle, lit-on dans Power and Progress de Daron Acemoglu et Simon Johnson. Le recours à de nouvelles technologies et machines « n’a pas augmenté les revenus des salariés pendant près d’un siècle, écrivent-ils, au contraire, comme les ouvriers du textile en ont brutalement pris conscience par eux-mêmes, la durée du travail s’est allongée et les conditions de vie ont été terribles, dans les usines comme dans les villes surpeuplées. » Les mineurs de charbon, y compris des enfants, travaillaient dans des conditions encore plus déplorables.
La Révolution de l’information est comparable aux premières décennies de la Révolution industrielle, affirment les auteurs. Depuis 1980, sous l’effet conjugué de la mondialisation et de l’automatisation, nous avons accès à un éventail extraordinaire de nouveaux produits, ce qui est en partie possible grâce à la création de chaînes d’approvisionnement mondiales. Les deux phénomènes « se sont renforcés l’un l’autre, déclenchés tous deux par une même volonté de réduire les coûts de main-d’œuvre et de mettre en touche les travailleurs ». En conséquence, les salariés, notamment les ouvriers peu qualifiés des pays avancés, n’ont pas partagé les fruits de la prospérité, d’où l’émergence de sociétés à deux vitesses. Aux États-Unis par exemple, « les salaires réels de la plupart des travailleurs ont à peine augmenté » depuis 1980. Seuls 50 % des enfants nés en 1984 aux États-Unis gagnaient plus que leurs parents, contre 90 % de ceux nés en 1940. Les conditions de travail ne sont peut-être pas aussi déplorables que pendant la Révolution industrielle ; pour autant, l’absence de débouchés a causé de nombreuses « morts de désespoir », pour citer les économistes Anne Case et Angus Deaton. Dans bon nombre de pays, la part du travail dans le revenu national a diminué, allant de pair avec une augmentation de celle du capital.
Heureusement, des cas de partage plus global des fruits du progrès technologique ont aussi été recensés par le passé, ce que les auteurs appellent « prendre le train de la productivité ». Cela se produit lorsque, fortuitement ou délibérément, la technologie accroît la productivité des travailleurs, plutôt que d’évincer tout simplement ces derniers, ce qui crée une multitude de nouveaux emplois. Cette tendance nécessite que les salariés trouvent des solutions pour s’approprier une part de la nouvelle prospérité. Après des débuts médiocres, la Révolution industrielle a finalement pris cette tournure. Ce résultat a été obtenu à mesure que l’on a pris conscience « qu’au nom du progrès, une grande partie de la population s’appauvrissait » et que les ouvriers se sont syndiqués pour exiger de meilleurs salaires et conditions de vie. Ainsi, au Royaume-Uni par exemple, entre 1840 et 1900, les salaires ont augmenté de plus de 120 %, soit plus que la productivité (90 %).
Les trois décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont aussi été une ère de prospérité partagée. Les nouvelles technologies adoptées à cette période n’étaient pas essentiellement destinées à réaliser des économies via l’automatisation. Elles ont été à l’origine de « multiples tâches, produits et possibilités inédits ». Les salariés se sont regroupés dans des syndicats afin de recevoir leur juste part des profits. La part du travail dans le revenu national a ainsi augmenté durant cette période, signe que les technologies étaient adaptées aux besoins des travailleurs et que les employeurs partageaient les bénéfices engrangés.
Les prochaines décennies seront-elles marquées par une prospérité partagée ou par une poursuite de l’évolution vers des sociétés à deux vitesses ? D. Acemoglu et S. Johnson concluent : « il est tard, mais peut-être pas trop tard » pour changer de cap. Le dernier chapitre ne manque pas d’énumérer les mesures, plus d’une dizaine au total, que les sociétés peuvent prendre pour y parvenir : du « démantèlement des géants du numérique » à une « réforme de l’Université ». La mesure la plus importante au regard des propres faits historiques des auteurs est « l’organisation des salariés », la question étant de savoir si les travailleurs seront aptes et habilités à se syndiquer afin d’améliorer leurs salaires et conditions de travail. Les données recueillies pour le moment ne sont pas explicites. Si la syndicalisation a légèrement progressé dans de nombreux pays, ces tentatives se sont heurtées à l’opposition d’entreprises et ont échoué pour beaucoup d’entre elles. Les auteurs auraient pu lancer « Travailleurs du monde entier, unissez-vous ! » si ce slogan n’avait pas déjà été utilisé.
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.








